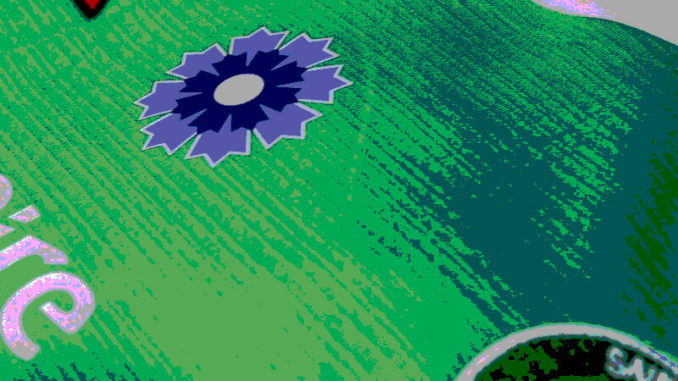
Chaque saison, à l’occasion de la commémoration du 11 novembre, le football hexagonal s’associe à l’Œuvre nationale du Bleuet de France, un organisme géré par l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Derrière leur apparente neutralité, ces hommages ont une forte dimension idéologique et ne sont pas discutés.
En France, des footballeurs sont capables de boycotter la journée contre l’homophobie et ses maillots aux couleurs arc-en-ciel, mais aucun ne semble gêné par celle dédiée au Bleuet de France, œuvre de charité patriote créée en 1916 par des infirmières militaires, pour venir en aide aux mutilés de la Grande Guerre. Des bleuets en tissus étaient alors vendus dans la rue pour financer ce soutien, sous l’oeil bienveillant du ministère de la Guerre. Cette fleur a été choisie comme symbole car c’est “une des seules à pousser sur les champs de bataille, mais aussi car elle rappelle le bleu de l’uniforme des premiers poilus”, vante le ministère des Armées. De fait, le Bleuet de France est indissociable de l’appareil militaire.
En Ligue 1 comme en Équipe de France, le Bleuet ne fait pas débat
A l’occasion de la réception de l’Ukraine, les joueurs de l’Équipe de France arboreront un bleuet sur leur maillot. Si cette alliance entre ces deux objets patriotiques n’est pas surprenante, depuis plusieurs saisons, il existe aussi un partenariat entre la Ligue de Football Professionnel (LFP) et l’Œuvre nationale du Bleuet de France. Joueurs de L1 et de L2, staffs techniques, journalistes et commentateurs se parent eux aussi du bleuet, dans un unanimisme assez déconcertant.
Ce partenariat avec le football français permet de récolter des fonds, notamment via la vente aux enchères d’une partie de ces maillots frappés du fameux badge. En mai 2025 à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération, la LFP a par exemple versé 36 000 euros au Bleuet de France, récoltés grâce à la vente de 97 maillots portés par les joueurs lors de Ligue 1 et de Ligue 2 en novembre 2024. L’organisme rappelle que ces dons servent “à la solidarité avec nos soldats en opérations extérieures”.
Sous couvert d’un cadre caritatif et prétendument apolitique, le monde du football s’intègre à ce consensus patriotique. Profitant de la surface médiatique du sport-roi, le Bleuet sert un récit d’union nationale qui dilue les antagonismes sociaux, sans réel débat ni recul critique sur les interventions militaires françaises ou leur héritage colonial. Outre-Manche, le Poppy s’est aussi rendu indiscutable. Il n’y a longtemps eu guère que l’international irlandais James McClean pour refuser de l’accrocher à son maillot.
La mémoire officielle et ses trous volontaires
Comme le Poppy britannique, d’abord créé en hommage aux soldats britanniques morts dans la boucherie des tranchées de 14/18 avant de devenir un symbole à la gloire de l’armée britannique et de ses guerres impérialistes, le Bleuet a élargi son champ commémoratif au fil du temps. Aujourd’hui, il symbolise le soutien aux hommes et femmes ayant “risqué leur vie pour la France” au sens large. Ce qui comprend autant les victimes d’actes terroristes, les anciens combattants, les orphelins et des veuves de guerre, que les soldats morts ou blessés en “OPEX” (les opérations extérieures).
Le Bleuet cherche en effet à renforcer un lien émotionnel à l’armée française en neutralisant toute approche critique. Depuis 2020, le Bleuet de France s’est trouvé un ambassadeur sur mesure avec Franck Lebœuf, jamais avare de patriotisme douteux. On se souvient de ses propos lors du Mondial 2018, glorifiant cette France “partie en guerre partout”. Des mots que n’auraient pas renié le baron Coubertin qui exaltait chez les jeunes sportifs, “l’ambition de découvrir une Amérique, de coloniser un Tonkin et de prendre un Tombouctou”.
Loin de celle de Jean Ferrat, la France du Bleuet est fière de ses guerres colonialistes. Le site officiel de l’Œuvre dédie des pages aux Mémoriaux d’Indochine, d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. À l’inverse, les manifestations de refus de la guerre que sont les mutineries de 1917 ou les monuments pacifistes de Gentioux, d’Avion ou de Sermages, sont invisibles, comme effacées de l’Histoire. Servant sur un plateau une mémoire soluble dans le roman national, le Bleuet de France est l’antithèse de cette histoire sociale.
Un rappel nécessaire: lutter contre toutes les guerres
En se voulant apolitique et universel, le port du bleuet masque les causes structurelles des guerres: rivalités capitalistes, haines identitaires et convoitises territoriales. Mais il ne s’agit pas de réfléchir, juste de se plier à l’injonction émotionnelle. À l’ère du sportwashing, alors que perdurent les massacres au Moyen-Orient ou en Afrique, la fonction idéologique du Bleuet de France consiste à glorifier le sacrifice des soldats tout en invisibilisant la dimension de classe de la guerre. Car les discours les plus belliqueux viennent bien souvent de ceux qui ne courent aucun risque. C’est un des messages de la Chanson de Craonne, adressé à la bourgeoisie: “Si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau”.

LUTTER CONTRE TOUTES LES GUERRES!